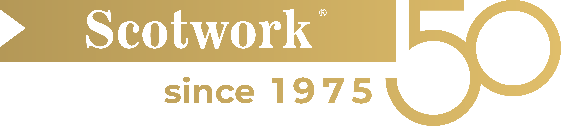Définir la négociation : entre histoire, culture et pratique
Origine et évolution du mot « négociation »
Le Dictionnaire culturel Le Robert souligne que le mot négociation date de 1323, signifiant d’abord « affaire », puis « fait de commercer ». Il est emprunté au latin negotiatio, signifiant « commerce ». À l’origine, le mot « commerce » relevait du relationnel avant de s’élargir à une dimension marchande, tout en conservant la notion d’échange.
Dans son sens courant, la négociation désigne une série d’entretiens, d’échanges de vues ou de démarches entrepris pour parvenir à un accord, pour conclure une affaire.
Les définitions selon les dictionnaires
Pour le Littré, la négociation est « l’action d’arranger les différends publics et surtout internationaux ».
Le Larousse évoque quant à lui les notions de débat, de transaction et de compromis à travers des synonymes comme : débattre, traiter, discuter, transiger, concéder ou encore rechercher un terrain d’entente.
La négociation, un pilier des relations humaines
L’histoire et l’actualité montrent que la négociation est au cœur des relations humaines, qu’elles soient privées ou professionnelles. Véritable art de vivre ensemble, elle permet de résoudre les conflits sans recours à la force, de construire des relations durables et d’inscrire nos échanges dans une logique gagnant-gagnant.
La définition de la Négociation selon Scotwork
La négociation est le procédé par lequel des parties en conflit ou ayant des différences d’intérêts ajustent leurs positions en effectuant des concessions sur des points de moindre importance, afin d’obtenir des avancées sur les points essentiels. L’accord final doit impliquer toutes les parties. Leurs interdépendances les conduisent à rechercher ensemble une solution prenant en compte la réalité de chacun.